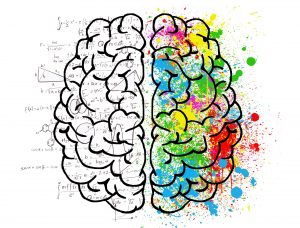Un bilan neuropsychologique est composé d’entretiens cliniques et de la passation d’un test évaluant les capacités cognitives de l’enfant. Le test est lui-même composé d’au maximum 15 épreuves construites selon les modèles théoriques du développement cognitif de l’enfant.
Qu’est-ce alors que la « fonction cognitive » ?
C’est l’équivalent de ce que l’on pourrait appeler une fonction cérébrale ou intellectuelle. Pour effectuer une tâche, le cerveau analyse l’information selon un modèle d’input/ output. Il va donc y avoir plusieurs mécanismes : l’entrée de l’information, son traitement ou réponse, et la sortie de l’information. Les fonctions cognitives rendent possible l’ensemble du processus. Elles représentent les capacités d’adaptation à l’environnement extérieur et les capacités d’équilibre du monde interne. Elles sont à la base des apprentissages scolaires :
- La fonction langagière (lecture, capacité orale, d’expression, écrite, etc…)
- Les praxies diverses (capacités à pouvoir utiliser son corps comme un outil sensori-perceptif et kinesthésique)
- La mémoire
- La concentration
- Les fonctions exécutives (capacités à mettre en place des stratégies, à résoudre un problème)
La nature de la tâche à réaliser par le système cognitif peut varier, par exemple linguistique, mnésique, spatiale et d’autres. Les fonctions cognitives peuvent dysfonctionner, on parlera alors de troubles cognitifs : globaux quand une déficience homogène est diagnostiquée ; partiels quand ils ne touchent qu’une fonction cognitive particulière comme c’est le cas dans la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, etc… Les troubles cognitifs peuvent avoir un retentissement sur le développement de l’enfant. Il peut se sentir découragé, avoir une baisse de l’estime de soi, devenir anxieux ou agressif. L’analyse des éléments cliniques lors de la passation est indissociable de l’analyse des données brutes obtenues au test. Il est également important de remettre le bilan dans son contexte, d’étudier l’origine de la demande et d’effectuer l’anamnèse de l’enfant.
Qui demande un bilan neuropsychologique ?
Le milieu scolaire demande souvent en premier la passation d’un bilan, en lien avec le médecin de l’école. Parfois ce sont les parents qui le demandent, souvent quand ils ont identifié un comportement ou profil atypique chez leur enfant. Certaines situations parlent d’elles-mêmes et poussent les adultes à s’interroger :
- Un échec scolaire inexpliqué et /ou soudain
- Une discordance importante entre les matières ou les domaines d’activité de l’enfant
- Un autre bilan (psychomoteur ou orthophoniste) a mis en lumière une difficulté
- Des troubles du comportement en classe ou à la maison, un retard accumulé
La restitution
Le compte-rendu que le praticien va faire ne saurait être restitué de la même façon aux différents interlocuteurs.
Pour le médecin ou le milieu scolaire, on effectue un compte-rendu concis, répondant à la problématique posée lors de la demande. On utilise un vocabulaire clair et non technique, en décrivant le développement cognitif de l’enfant et en le positionnant par rapport à la moyenne des enfants de son âge.
Pour les parents, on replace l’objectif de passation et on demande quels ont été les ressentis de la famille. Il faut être attentif à ne pas donner de réponse figée dans le temps, qui catégorisera l’enfant et pourra induire certains comportements pédagogiques de la part des parents. Toutefois, il est important d’apporter des réponses aux parents, à leur apporter des pistes ou des relais de prise en charge.
Comme on peut l’observer, il est important quelque soit le contexte, de relativiser les données obtenues par la passation et de les mettre en perspective par rapport à l’objectif ou la demande. Le compte-rendu est essentiellement un outil de communication sur le fonctionnement cognitif de la personne testée, il mettra en avant :
- Les projets de rééducation ou d’adaptation pédagogique
- La reconnaissance de la difficulté / de la précocité rencontrée dans tel fonctionnement cognitif
- Une vision dynamique des capacités de l’enfant